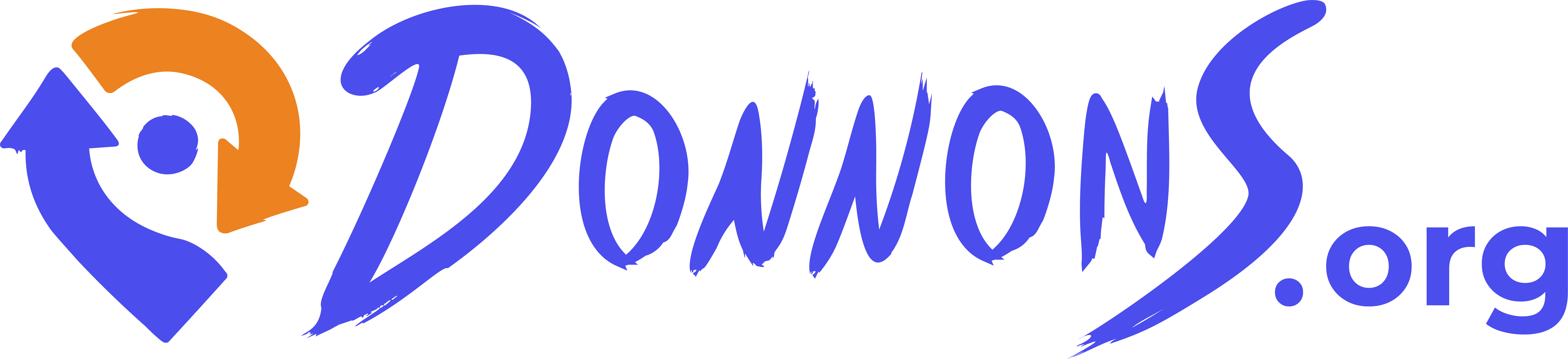Alors, au départ, on voulait vous parler de l’envers du décor de l’industrie du meuble et de la filière forestière qui l’alimente (il y a d’ailleurs un excellent documentaire sur Arte à ce sujet, vous l’avez vu ?).
Et puis, en discutant entre nous, on a réalisé que nous avions tous chez nous des meubles en bois pas toujours très certifié… Alors qu’on se considère plutôt sensibilisés à l’écologie. Mais pourquoi est-il si difficile d’aligner nos comportements avec nos principes écologiques ?
Ce tiraillement moral a été largement étudié par l’ObSoCo. En 2023, l’une de leurs enquêtes révélait, par exemple, que 60 % des Français exprimaient le souhait de consommer autrement, une proportion en constante progression. En même temps, 22% des colis gérés par la Poste provenaient de deux grandes marques d’ultra fast-fashion.
Ce phénomène, connu sous le nom de « green gap », met en lumière les contradictions écologiques qui jalonnent nos comportements de consommation. Il permet surtout de dépasser l’idée simpliste d’une opposition entre, d’un côté, des consommateurs éclairés et responsables, et de l’autre, des consommateurs ignorants et polluants.
Bref, on parlera une autre fois de l’industrie forestière.
Le paradoxe de la noix de cajou.

Non on a pas changé de sujet. On a concocté un concept (maison) pour tenter une première explication : le paradoxe de la noix de cajou. Ne cherchez pas sur Google, ça n’existe pas ailleurs que chez Donnons.org (et ça vaut ce que ça vaut..)
C’est quoi, ce paradoxe ?
Quand vous mangez une noix de cajou, vous pensez faire un choix anodin, voire positif : un fruit sec, bon pour la santé, naturel, végétarien. Bref, il semble cocher toutes les cases. Et pourtant… derrière la petite noix se cache une réalité beaucoup moins reluisante :
- Sa récolte artisanale provoque encore aujourd’hui de graves brûlures aux yeux et aux mains des ouvriers, à cause d’une substance corrosive libérée lors de l’épluchage : l’acide anacardique.
- Comme elle n’est pas produite en Europe, elle parcourt des milliers de kilomètres en avion avant d’arriver dans nos rayons.
Résultat : vous participez en fait (sans le vouloir) à un système aux conséquences sociales et écologiques lourdes.
Pourquoi on vous parle de ça ?
Pour illustrer la difficulté, voire l’impossibilité, de mesurer individuellement l’impact réel de chacun de nos gestes et de nos habitudes. L’impact, négatif ou positif, d’un produit sur l’environnement, est souvent difficile à mesurer pour les consommateurs. En plus, les marques font tout pour nous le cacher, certaines pratiquent même le greenwashing, faisant passer des produits très nocifs pour de vrais choix responsables.
Mais ce paradoxe n’explique pas tout. Même quand la nocivité d’un produit est évidente (pour l’environnement, la santé, etc.), il reste parfois largement consommé, nourrissant par la même occasion nos contradictions écologiques.
Un problème de striatum dites-vous ?

Maintenant qu’on a développé notre petite théorie,on a été voir du côté de la science. On s’est intéressé aux explications du neurobiologiste Sébastien Bohler qui a étudié notre comportement incohérent face au changement climatique dans son livre Human Psycho (Bouquins, 2022).
Et cette incohérence proviendrait tout simplement de notre cerveau…
Le scientifique distingue deux parties du cerveau, le cortex cérébral et le striatum. Le premier est celui qui nous permet de prendre conscience du changement climatique, de l’appréhender et de le mesurer. C’est aussi grâce à lui que nous avons pu inventer des outils, interagir collectivement, faire des mathématiques, etc. : c’ est la partie “intelligente” de notre cerveau. Puis vient le striatum (on l’attendait), qui lui n’a que très peu évolué depuis la naissance de l’humanité. Cette partie est celle qui nous pousse à agir et qui active le fameux circuit de la récompense. C’est elle qui sécrète la dopamine, l’hormone liée au plaisir, en réponse à certains comportements. Ceux-là même qui nous ont permis de survivre depuis des centaines de milliers d’années : manger, se reproduire, obtenir du pouvoir et chercher la place la plus avantageuse dans la société.
Cette manière d’agir et de réagir est donc présente dans chaque être humain et elle a un côté très addictif. Chaque fois qu’une action libère de la dopamine, cette dernière sera libérée en moindre quantité la prochaine fois que l’on adoptera la même action. Il faudra donc compenser par un comportement plus extrême ou plus régulier pour avoir la même dose de dopamine. C’est ce processus qui a poussé les humains à toujours en vouloir plus, à ne jamais être satisfait. Le principe de croissance est donc ancré dans le cerveau des humains, ce qui explique pourquoi ceux-ci ne sont jamais satisfaits, qu’ils ont toujours repoussé les limites et conquis des territoires pour obtenir toujours plus de ressources.
Autrement dit, consommer toujours plus est un processus chimique qui va souvent bien au-delà de notre volonté. Nos contradictions écologiques sont avant tout le résultat de ce processus, codé dans nos gènes.
De la prise de conscience à l’action : lutter contre nos contradictions écologiques
La première étape consiste à prendre conscience de l’impact réel de nos habitudes de consommation. Il ne s’agit pas simplement de « consommer moins », mais de consommer autrement, en identifiant les leviers d’action les plus efficaces au quotidien.
Pour cela, nous vous invitons à évaluer votre empreinte carbone à l’aide de l’outil proposé par l’ADEME (l’Agence de la transition écologique), accessible ici :
Connaissez-vous votre empreinte climat ?
Cet outil vous permettra de :
- Visualiser concrètement l’impact environnemental de vos comportements, dans des domaines comme l’alimentation, le transport, l’énergie ou les achats du quotidien ;
- Identifier les postes les plus émetteurs dans votre mode de vie ;
- Et surtout, découvrir des pistes simples et efficaces pour réduire durablement votre empreinte, sans nécessairement sacrifier votre confort.
Changer ses comportements ne passe pas uniquement par des contraintes : il s’agit souvent de réajuster ses choix à la lumière de nouvelles informations, pour retrouver une cohérence entre ses convictions et ses actions. Cet outil vous permettra d’identifier les postes de consommation les plus émetteurs (alimentation, transport, logement, achats, etc.) et de cibler les actions à prioriser.
Réconcilier son striatum et ses choix de consommation
Si notre striatum contribue parfois à des choix de consommation incohérents avec nos convictions, il est toutefois possible de le “hacker”. En effet, de nombreuses études montrent qu’un geste altruiste stimule le striatum et procure ainsi du plaisir.
1. Le plaisir de donner…
Altruisme et bien-être : Des études montrent que les comportements altruistes (donner, aider) augmentent le bien-être subjectif. Les personnes qui donnent ressentent souvent de la satisfaction, de la fierté et un sentiment de sens dans leur vie.
Effet “warm glow” : Les psychologues parlent du warm glow, ou “glow émotionnel” : un sentiment chaleureux et positif ressenti lorsqu’on fait un geste généreux, même petit.
Renforcement social : Donner peut aussi renforcer les liens sociaux, et le sentiment d’appartenance active les circuits de récompense.
2. …expliqué par la neurobiologie : dopamine et circuits de récompense.
Activation du système dopaminergique : Donner active le noyau accumbens (qui se trouve justement dans le striatum !) et d’autres régions du cerveau associées à la récompense et au plaisir, exactement comme lors de la nourriture, de l’exercice ou de relations positives.
Oxytocine et connexion sociale : L’acte de donner, surtout quand il est reconnu ou implique un lien humain, stimule la libération d’oxytocine, l’hormone du lien social et de la confiance.
Diminution du stress : Donner peut réduire le cortisol (hormone du stress), ce qui renforce la sensation de bien-être.
3. Les preuves expérimentales.
Une étude de Dunn, Aknin & Norton (2008) a montré que les participants qui dépensaient de l’argent pour les autres se déclaraient plus heureux que ceux qui dépensaient pour eux-mêmes.
Des expériences en IRM ont montré que le don activait les mêmes zones cérébrales que recevoir un gain monétaire.
Même de petits dons ou gestes symboliques suffisent à déclencher cette activation cérébrale.